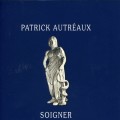Divers, 2011-2013
Signe vivant, revue Décapage, janvier 2013, n°46
… Lors de ce colloque, j’avais eu l’impression que le survivant que j’étais, à cause de cette part commune que je cernais en écrivant, était devenu un intouchable.
N’était-ce pas ce qui dans mon livre faisait se taire certains, mes médecins en particulier ? Un signe trop plein, une solitude sans remède, somme toute la manifestation d’un être humain qui va mourir, de toute façon, et pour qui on ne peut rien de plus que ce qu’on a déjà fait – puisqu’il est guéri.
Peut-être ne devais-je attendre de mes écrits ni consolation, ni le plaisir de cette affirmation, presque une revanche, qui sous-tendait mes envois : je vous montre ce que vous ne regardiez pas, ce moi dont vous ne considériez que le corps malade.
Peut-être devais-je aussi renoncer à espérer – ne savais-je donc pas que c’était illusoire ? – que mes livres réveilleraient ceux que la routine de l’hôpital semblait avoir insensibilisés…
Le ventre du temps, in Jouissance et souffrance sous la direction de Monique David-Ménard, janvier 2013, Éditions Campagne-Première »
… Tout n’est-il pas dans son début ? Il faut croire que non, puisque je ne suis pas mort.
Cela aurait pu être un prologue de mauvais thriller : le début des vacances, jour d’été, orage, un service d’urgences à Chicago.
Un chirurgien vient d’annoncer le diagnostic probable.Je dois être rapatrié. Il donne les conditions pour que je puisse voyager. Il faut attendre un ou deux jours pour savoir si je pourrai prendre l’avion.
Je me redresse et me rassemble. Je comprends. Ne comprends rien. Tout est clair. Ce qu’il dit m’enveloppe mais comme pour m’exclure de tout.
La réalité en anglais n’a plus d’humanité. Je parle cette langue, l’écoute mais elle est impénétrable soudain. Elle grogne partout autour de moi de cette façon froide et tranchante, pire que le vrai.
Il sort avec Benjamin. Des ombres à côté de moi, comme des atlantes impuissants.
Pleurer, crier, supplier. Silence.
Je découvre qu’il est terrifiant de mourir en dehors de son pays. Que le pays n’est que la langue où l’on a grandi. Non une langue de salut mais celle de la confiance…
L’enfant de Goya, Libres cahiers pour la psychanalyse, Partir, revenir, 2012, n°25
… C’est au Metropolitan museum de New York qu’on peut voir ce tableau de Goya : un petit garçon, habit de satin rouge, ceinture blanche. Il tient en laisse une pie. Une volière à côté de lui avec des chardonnerets, et derrière, regardant la pie avec une fixité allumée, trois chats.
Le garçonnet, dit l’histoire, est mort en bas âge.
Cette œuvre, Manuel Osorio Manrique de Zuñega, fut commandée par le Comte d’Altamira, qui venait de perdre son fils. Goya lui aussi avait perdu plusieurs de ses enfants.
Goya, le monde des ogres et des dévorateurs, des éventrés et des cris en lambeaux – qu’on devine dans les ténèbres derrière les oiseaux et les chats. Et dans ce portrait, quelque chose qui serre le cœur. Qu’y faire ? On sait bien comment ça se termine. C’est à mon grand-père que je pense chaque fois devant ce tableau. À son visage contenu quand j’étais malade, à celui terrible qui se décomposait lorsqu’il racontait comment il avait failli perdre sa fille, à cette scène de l’oiseau rescapé…
Se survivre, La Nouvelle Revue Française, Moi & Je, 2011, n°598
Nuit verte, Libres cahiers pour la psychanalyse, L’amour de transfert, 2011, n°23
… Enfant chez mon grand-père, j’avais installé ma cabane sous un grand lilas : elle était sans porte et sans mur, le feuillage seul m’isolait du monde. J’avais creusé le sol, pas beaucoup, juste assez pour délimiter un plan avec cuisine, salle de bain, chambre à coucher. Il y avait un trésor et un piège couvert de brindilles, au cas où viendraient des voleurs, et puis un lit pour mon cochon d’Inde. Les poules mettaient la pagaille, chaque jour je devais rebâtir le piège, débarrasser les feuilles sèches. J’avais de grands colloques avec mon compagnon à poils ras et gris perlé, dont on essayait de me défaire, parce qu’il m’avait transmis la teigne, et qui finirait à moitié dévoré par des rats. J’attendais des invités. Ils ne venaient jamais.
Est-ce ce creux que je retrouve ? Ça y ressemble. Sous le grand lilas, je prenais des décisions de la plus haute importance que j’allais annoncer à grands coups de marche aux quatre coins du jardin, comme certains soirs au poste de soins.
Nuit verte des urgences. Baldaquin d’émeraude, témoin des conciliabules.
Se recueillir.
Je ne vois, ne pense rien de précis. Je m’enracine et me déracine à la fois. Je deviens un palétuvier…